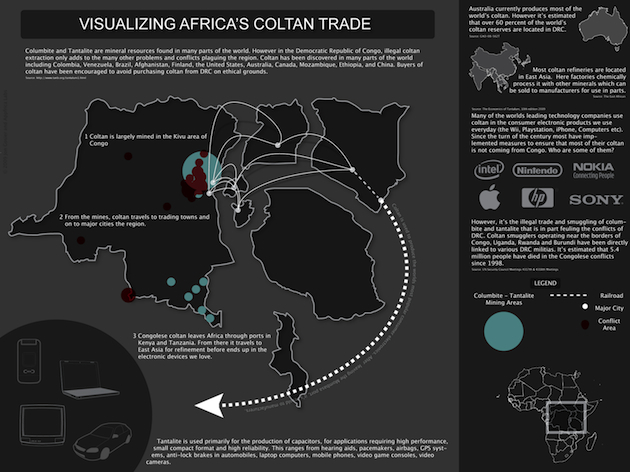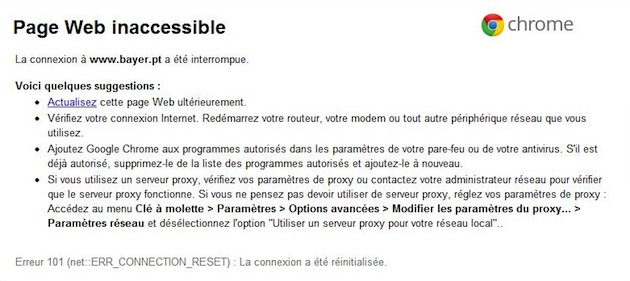Gao, Kidal,
Tombouctou : les trois capitales régionales du nord du Mali sont tombées
en moins de trois jours (du 30 mars au 1er avril 2012), deux mois après
le déclenchement de la rébellion, provoquant la débâcle de l’armée.
L’administration, les services publics et financiers ont été anéantis
dans l’ensemble du nord du pays par les rebelles touaregs et leurs
alliés islamistes, les cycles de production et les réseaux d’échange
désorganisés, ce qui laisse craindre une véritable désintégration
sociale dans cette région déjà très vulnérable aux aléas climatiques (à
l’automne 2011, les observateurs faisaient état d’un risque de crise
alimentaire grave dans la zone sahélienne). Au début du mois de mai, le
Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et la
Croix Rouge estimaient à 320 000 le nombre des réfugiés et des personnes
déplacées.
Le coup d’Etat du 22 mars à Bamako, la capitale du Mali, a affaibli
une armée déjà fragilisée par les défaites de Ménaka et Tessalit deux
mois plus tôt. Les auteurs du putsch, qui jugeaient « calamiteuse » la
gestion de la guerre au nord, ont largement contribué à briser la chaîne
de commandement militaire, ce qui a permis aux groupes rebelles de
prendre assez facilement le contrôle des deux tiers du pays. Ils avaient
d’ailleurs réussi à couper les routes d’approvisionnement et isoler
toutes les casernes du nord du pays qui sont tombées les unes après les
autres : Ménaka, dans la nuit du 17 janvier, puis Anderamboukane, et
Aguelhoc au nord de Kidal, où les rebelles se sont livrés à des actes de
barbarie sur des dizaines de soldats désarmés.

- La guerre au Mali : territoires occupés, réfugiés et personnes déplacée. Situation au 25 avril 2012.
- Esquisse cartographique : Philippe Rekacewicz, 2012
Le 1er et le 2 février, des femmes de soldats avaient manifesté pour
dénoncer les conditions du service dans le Nord et exiger que le
gouvernement s’occupe plus sérieusement du sort des militaires et de
leurs familles. D’abord interdites, les manifestations finalement
autorisées s’étaient transformées en émeutes et en attaques contre les
maisons et commerces des Touaregs et des Arabes.
Dans le même temps, les rebelles s’attaquaient à Niafunké après avoir
pris la petite ville de Léré, déjà évacuée par les soldats et la
population. Les biens des populations arabo-touarègues ont aussi été
détruits dans le sud du pays, à Bamako et à Kati (une petite ville à
quelques kilomètres au nord de la capitale), ainsi qu’à Ségou et
Sikasso, provoquant des départs massifs vers le Burkina Faso et la
Mauritanie. Ces événements ont profondément endommagé la cohésion
sociale entre ces communautés.
Alors que Bamako retrouvait son calme, la guerre continuait dans le
désert, et l’armée régulière malienne subissait revers sur revers. A la
mi-mars, les rebelles ont fait tomber la garnison de Tessalit, à la
frontière avec l’Algérie. La prise de cette ville coïncidait avec
l’apparition publique d’Iyad Ag Ghali, le chef du mouvement islamiste
touareg Ansar Dine. Dans des vidéos, il ne cachait pas son objectif :
imposer la loi islamique sur le Nord Mali. Jusqu’alors, la rébellion
semblait monopolisée par le Mouvement national de libération de
l’Azawad (MNLA), qui se battait pour l’indépendance du nord du pays.
Le coup d’Etat à Bamako devait précipiter la chute des derniers
bastions comme Kidal, point de mire du MNLA, d’Ansar Dine et ses alliés
d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), mais aussi les villes-symboles
de Gao et Tombouctou. Dans la dernière semaine de mars, les rebelles
contrôlaient tous les accès entre Niafunké, au bord du fleuve Niger
jusqu’à Tessalit, au Nord, près de la frontière avec l’Algérie, et
pouvaient planter leur drapeau sur l’ensemble de la région qu’ils
revendiquent. Le 6 avril, ils déclaraient la naissance de la République
indépendante de l’Azawad.
Gao sous contrôle rebelle, un mois après
Kidal est tombée le 30 mars. Le lendemain, c’est au tour de Gao et
ses deux garnisons, dont celle qui porte le nom de Firhoun Ag Alensar,
le chef de la tribu Oulliminden qui a résisté à la colonisation
française en combattant dans le sud-est jusqu’à sa capture dans la
petite forêt d’Anderamboukane en 1916. Elle abrite d’importantes unités
de combat blindées.

- A Gao, Mali.
Les combats ont duré une journée. Une guerre en direct, rapportée
minute par minute par SMS, par téléphone et sur les réseaux sociaux, par
les habitants cloîtrés chez eux. A la fin de la journée, la situation
était très confuse, certains croyaient que l’armée avait repoussé les
assaillants, d’autres avaient clairement compris que la ville de Gao
était désormais contrôlée par les rebelles du MNLA, d’Ansar Dine et
d’AQMI.
Les six banques, l’hôpital régional, les pharmacies, les
organisations humanitaires et bâtiments administratifs ont été saccagés.
Le pillage des commerces continuera des jours durant. Les deux marchés
du centre-ville, qui avaient brûlé en 2008 et 2010, sont à nouveau
anéantis. Avec la destruction des banques, la plupart des salariés n’ont
pu être payés. Une ville de plus de 85 000 habitants ne dispose plus
d’aucun service de base.
Même si Gao ne résonne pas dans l’imaginaire occidental comme Djenné
ou Tombouctou, la ville – créée autour du VIIe siècle – est l’une des
plus vieilles de la région, pendant longtemps siège du pouvoir de
l’ancien Empire songhay. Juchée sur la boucle du Niger juste au niveau
du méridien de Greenwich, elle est sise au croisement des routes reliant
Bamako à Niamey, Ouagadougou à Tamanrasset. De 2006 à 2007, la
construction du pont de Wabaria et le bitumage de la route vers Niamey
en ont fait une pièce maîtresse de la transsaharienne.
La rébellion touarègue, mais laquelle ?
Dès la première semaine, les contours de cette rébellion polymorphe
commençaient à se dessiner. Alors que la fraction séparatiste incarnée
par le MNLA fanfaronnait avec ses communiqués de guerre et sa
déclaration d’indépendance, les islamistes touaregs d’Ansar Dine se
présentaient sur le terrain comme les garants de la sécurité et du
bien-être de la population. Les dirigeants islamistes rencontrèrent
successivement les chefs traditionnels et religieux et distribuèrent des
numéros de téléphone que les gens pouvaient appeler en cas de danger…
Dans les jours qui suivirent, le MNLA avait à gérer les conséquences
politiques et diplomatiques de ses tonitruantes déclarations.

- A Gao.
A la fin du mois d’avril, le MNLA organisait enfin une rencontre avec
les chefs traditionnels et religieux de Gao, pour discuter des
problèmes de gestion de la ville. Les responsables d’Ansar Dine en
étaient absents : son porte-parole à déclaré que son mouvement ne se
sentait pas concerné. Au même moment, il procédait à la libération de
l’otage suisse Beatrice Stöckly, kidnappée à Tombouctou neuf jours plus
tôt, la remettant directement aux médiateurs de la présidence burkinabé.
La veille, ils avaient livré 160 prisonniers (des soldats maliens) au
Haut conseil islamique du Mali (HCI), dirigé par Mahmoud Dicko, un imam
d’obédience wahhabite. Deux opérations fort bien médiatisées…
Ansar Dine a su en outre regagner un peu de confiance au sein de la
population, en répondant aux appels de détresse, et en aidant à
récupérer des biens volés. Le MNLA, qui poursuit d’autres objectifs,
souffre d’un handicap majeur dans l’opinion : le mouvement est assimilé
aux actes de pillage, confiscation de biens, enlèvements et viols. Les
indépendantistes sont considérés comme des bandes de maraudeurs
indisciplinés qui attaquent et dépossèdent.
Cibles de la furie salafiste, les églises ont été démolies, tout
comme les bars et autres lieux de divertissement – à Tombouctou, le
mausolée d’un saint musulman a même été profané le 4 mai, son culte jugé
idolâtre. On estime que deux cents chrétiens vivaient à Gao. Ils
auraient tous fui ou pris refuge dans les villages. Cette violence
anti-chrétienne inédite tranche avec la tradition musulmane locale, au
point que même le président du HCI l’a dénoncée, en réaffirmant la
coexistence des animistes, chrétiens et musulmans dans le pays, parfois
au sein de la même famille.
Chérif Ousmane Madani Haïdara, à la tête d’une confrérie
traditionaliste plus ancienne également dénommée Ansar Dine (en arabe,
« les défenseurs de la foi »), a même revendiqué le caractère laïc de
l’Etat malien et accusé la rébellion wahhabite d’avoir usurpé le nom de
son association. Haïdara avait déjà critiqué l’emprise wahhabite sur le
HCI. Cette hostilité s’explique par l’histoire du pays. L’islam
traditionnel a été façonné par les confréries soufies. Le wahhabisme est
arrivé vers 1930, mais ne s’est réellement implanté qu’à partir de
1950 ; à Bamako, des wahhabites ont rapidement prospéré dans le
commerce ; en mai 1957, de violentes émeutes ont visé maisons et
commerces – une violence sous fond de ressentiment économique.
Les relations entre Ansar Dine et la communauté wahhabite sont
imprévisibles. La région de Gao a été très déstabilisée par le retour,
il y a quarante ans, de ressortissants convertis au wahhabisme dans les
années 1960 et 1970. La plupart avaient quitté la campagne pour faire
des études coraniques au Niger et au Nigeria. Certains avaient pu aller
jusqu’au Soudan et en Arabie saoudite, berceau du wahhabisme. Ils ont
commencé à vouloir convertir à leur vision de la religion des familles
et des notables, puis à recruter de nouveaux disciples en jouant sur les
relations familiales. Leur attitude expansionniste et agressive allait
déclencher une réaction violente au sein d’une population plutôt acquise
aux rites soufis, avec une forte coloration de croyances
traditionnelles. En fait, l’ancienne religion du fleuve dont les
cérémonies annuelles étaient conduites publiquement par le « harikoy »
(maître des eaux du fleuve) et les rites de la brousse dits de
« hawka », coexistaient très pacifiquement avec l’islam traditionnel.

- A Gao.
Finalement, les forces de la communauté wahhabite se déplaceront vers
les villes, où le commerce avec le Proche-Orient a enrichi un grand
nombre de négociants qui investissent dans les médersas (écoles
coraniques) et les médias pour accentuer leur influence politique,
devenue perceptible aux élections de 2002. En août 2009, l’opposition à
la réforme du Code des personnes et de la famille fut menée par l’imam
Mahmoud Dicko avec des marches auxquelles ont participé des dizaines de
milliers de manifestants à Bamako ou à Gao : en tête de cortège, des
femmes habillées en noir de la tête aux chevilles. Cette mobilisation
avait forcé le président malien à vider la loi de toutes les avancées
significatives pour les femmes.
Les années 1970 marquent donc la fin d’une ère, qui a débuté au tout
début du XVIIe siècle. Avec la chute de l’Empire songhay en 1591, aucun
Etat central ne pouvait plus assumer un pouvoir fort sur les populations
de la boucle du Niger. Les communautés se sont alors organisées de
façon autonome, avec des périodes de guerre et de paix entre certaines
tribus nomades et les communautés riveraines. Des conflits à répétition
avec les chefs touaregs à la cruauté de la colonisation française, la
région a une histoire mouvementée.
Cette « mémoire » reste bien vivante, et les rebelles s’en servent
pour justifier leur campagne guerrière. Mais chaque communauté a
potentiellement une mémoire de domination et de résistance ou un récit
« micronational », parfois épique, parfois tragique, qui d’ailleurs peut
varier au sein de la même communauté culturelle et linguistique. Ces
nuances disparaissent lorsque les « seigneurs de guerre » ayant grandi
en Libye ou en Algérie parlent de l’Azawad comme du berceau exclusif
d’un groupe ethnique.
Cohabitation entre MNLA et Ansar Dine :
le prologue de Gao
Durant les deux premiers mois de la rébellion, on a surtout entendu
parler du MNLA. A la fin du mois de janvier, Iyad Ag Ghali, le chef du
mouvement islamiste Ansar Dine a revendiqué les attaques d’Aguelhoc et
de Tessalit comme ses propres victoires. Les ambitions commencaient à
s’aiguiser ; les chemins des rebelles tendaient à bifurquer. Ansar Dine
combat aux côtés des indépendantistes du MNLA, mais prend des positions
inverses avec, par exemple, la volonté d’imposer la charia sur toute
l’étendue du territoire malien. Cette composante islamiste, dont le MNLA
s’était accommodé jusque-là pour défaire l’armée malienne, devient
maintenant plutôt encombrante.
Après quelques semaines de cogestion de la ville de Gao, Ansar Dine
semble tenir la ville d’une main de fer, bien que le MNLA déclare
contrôler les frontières « externes » et semble se préparer à se
débarrasser d’Ansar Dine et ses alliés djihadistes dès que ce sera
possible. Le dilemme du MNLA se situe exactement à ce niveau et
ressemble curieusement à celui du gouvernement malien qui aurait un
moment toléré la présence des salafistes et ignoré l’angoisse de ses
voisins algériens et mauritaniens. Finalement, le Mali a essayé d’agir à
un moment où il n’avait déjà plus les moyens de contrer la coalition
de groupes armés sur son territoire.
Aujourd’hui, les accrochages entre les hommes d’Ansar Dine et du MNLA
sont si fréquents qu’il n’est plus possible de nier la fracture
grandissante entre les deux camps, même s’ils arrivent souvent à limiter
les dégâts à temps. A la cuisante défaite de l’armée malienne succède
donc l’ouverture d’un nouveau front qui mène le nord du pays vers un
avenir incertain. Mais il est clair que la justice qui règne à Gao
depuis avril est bien celle d’Ansar Dine – la charia dans sa version
wahhabite – et non pas le droit laïc et révolutionnaire promis par le
MNLA.
Stratégies de survie
Tant bien que mal, des actions de solidarité sont organisées depuis
Bamako, pour la population bloquée au nord du pays. Les premiers convois
de vivres et de médicaments envoyés par le Collectif des ressortissants
du Nord (Coren) et des associations de villages sont arrivés à la
mi-avril. Cet effort continue avec l’opération « cri de cœur », du nom
d’un collectif de jeunes qui utilisent des numéros surtaxés mis à leur
disposition par les compagnies de téléphones mobile pour récolter des
fonds. Les sommes recueillies ont permis d’acheter des vivres et des
médicaments.
Mais l’aide la plus déterminante provient des familles elles-mêmes.
Où qu’ils se trouvent, les gens s’organisent pour aider leurs parents à
survivre. Un système de troc s’est mis en place, puisqu’il est
impossible d’envoyer de l’argent par la banque. Les échanges se limitent
aux denrées de base et aux médicaments. Le procédé consiste à verser
l’argent à une personne à Bamako ou à Niamey qui demande à une autre à
Gao de donner une quantité de céréales ou de condiments à un
correspondant. Tant que le système marche, les transactions peuvent se
faire sans que l’argent ne « voyage ».
Les pillages ont affaibli les stocks, et les commerçants sont
discrets sur leurs réserves. Ce qui contribue à faire monter
considérablement les prix. Ce système en vase clos s’effondrera tôt ou
tard si la situation persiste et si la région n’a pas la possibilité de
se réapprovisionner. En attendant, en quête de légitimité après la
démolition délibérée de la ville, chaque camp se profile en meilleur
gardien de ses ruines.
A lire
 Touaregs, la « marche en vrille » par Hawad, mai 2012.
Touaregs, la « marche en vrille » par Hawad, mai 2012.
Les soulèvements armés touaregs qui ont jailli depuis les années
1960 au Mali, au Niger ou en Algérie ne sont pas surprenants ou
imprévisibles : ils s’inscrivent dans la prolongation de la résistance
des Touaregs aux empires coloniaux.
 Comment le Sahel est devenu une poudrière par Philippe Leymarie, avril 2012.
Comment le Sahel est devenu une poudrière par Philippe Leymarie, avril 2012.
Le coup d’Etat militaire qui, le 22 mars, a renversé le régime
« modèle » du président malien Amadou Toumani Touré a ajouté à la
confusion régionale. Secouée par les nouvelles rébellions de mouvements
touaregs, la bande saharo-sahélienne pâtit également de l’impunité des
groupes armés se réclamant d’Al-Qaida au Maghreb islamique.
 Au Sahel, un nouveau front à haut risque par Philippe Leymarie, Défense en ligne, Les blogs du Diplo, septembre 2010.
Au Sahel, un nouveau front à haut risque par Philippe Leymarie, Défense en ligne, Les blogs du Diplo, septembre 2010.
L’enlèvement au Niger de sept employés d’Areva et Vinci, quels qu’en
soient les développements à venir, constitue un défi lancé au
gouvernement français ainsi qu’à l’ensemble des pays des confins
sahariens, qui jouent chacun leur jeu dans une partie de billard à
plusieurs bandes.
 Le Nord Mali victime d’une prophétie autoréalisatrice par Jean-Christophe Servant, Echos d’Afrique Les blogs du Diplo, décembre 2009.
Le Nord Mali victime d’une prophétie autoréalisatrice par Jean-Christophe Servant, Echos d’Afrique Les blogs du Diplo, décembre 2009.
La situation régnant dans le Nord Mali est de plus en plus complexe
et brouillée, l’imbrication des facteurs géopolitiques, humains,
économiques dans cette zone ne permettent que d’échafauder des
hypothèses.
 Recension du livre Les rébellions touarègues d’Anne Saint Girons par Cédric Gouverneur, mai 2009.
Recension du livre Les rébellions touarègues d’Anne Saint Girons par Cédric Gouverneur, mai 2009.
 Vers la réintégration des Touaregs au Mali par Robin Edward Poulton, novembre 1996.
Vers la réintégration des Touaregs au Mali par Robin Edward Poulton, novembre 1996.
 Nouvel enlisement des espoirs de paix dans le conflit touareg au Mali par Philippe Baqué, avril 1995.
Nouvel enlisement des espoirs de paix dans le conflit touareg au Mali par Philippe Baqué, avril 1995.
 Les Touaregs : un exil perpétuel ?
Interview de Mohamed Mahmoud Sidi, président de l’Organisation pour
l’assistance aux enfants malades et en situation difficile (OAEMSD) par
Intagrist El Ansari, 6 mai 2012.
Les Touaregs : un exil perpétuel ?
Interview de Mohamed Mahmoud Sidi, président de l’Organisation pour
l’assistance aux enfants malades et en situation difficile (OAEMSD) par
Intagrist El Ansari, 6 mai 2012.
 Dans l’atlas 2012 du Monde diplomatique, Mondes émergents, « Al-Qaida s’enracine au Sahara », de Jean-Pierre Filiu.
Dans l’atlas 2012 du Monde diplomatique, Mondes émergents, « Al-Qaida s’enracine au Sahara », de Jean-Pierre Filiu.
En 2007, le Groupe salafiste pour la prédication et le combat
annonce son allégeance à Oussama Ben Laden et crée AQMI. Cette
organisation, dirigée depuis la Kabylie, a poursuivi le harcèlement
djihadiste des forces algériennes de sécurité. Malgré la forte
médiatisation des enlèvements d’otages occidentaux dans la zone
sahélienne, elle est affaiblie par des rivalités de chefs et se révèle
incapable de compromettre le processus démocratique au Mali comme au
Niger.